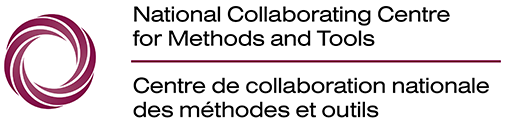Description
Inspiré du travail accompli aux Canadian Policy Research Networks, le Handbook on Citizen Engagement: Beyond Consultation est un document de référence concis sur l'intervention des citoyens. Il a pour but de combler le fossé entre l'État et les citoyens, en permettant aux décideurs de se remettre en prise avec les besoins, les priorités et les valeurs de ces derniers.
L'intervention des citoyens repose sur la croyance selon laquelle les gens devraient avoir leur mot à dire dans les décisions qui touchent leur vie. Le document concerne les fonctionnaires et les politiciens du fait qu'ils apportent des changements sociaux de l'intérieur du gouvernement.
Il existe quatre degrés d'intervention du public dans le processus décisionnel, sous des formes allant de passive à plus active. Les voici :
- communication avec le public : l'information est transmise du gouvernement au public, par des annonces, des rapports, des communiqués et des sites Web, notamment;
- consultation du public : le gouvernement demande au public d'intervenir sur un enjeu politique précis, en lui ayant fourni l'information nécessaire; les méthodes incluent les assemblées et les audiences publiques, les sondages d'opinion, les discussions en groupe et les référendums;
- participation du public : l'information est échangée entre le public et le gouvernement, et comprend le dialogue; l'interaction a pour objet de transformer l'opinion des deux parties en des jugements éclairés; les méthodes incluent des jurys, des panels et des dialogues de citoyens, des conférences consensuelles et des scrutins délibératifs.
L'intervention des citoyens est devenue la « nouvelle » participation du public. Elle vise à remplacer la participation symbolique par des moyens plus délibératifs d'intervenir de manière continue. Elle permet d'insister davantage sur le partage de l'information et des pouvoirs, le respect mutuel et la réciprocité entre les citoyens et leur gouvernement que les méthodes plus traditionnelles de participation du public au processus décisionnel.
L'intervention des citoyens renvoie à une participation du public caractérisée par une délibération interactive et itérative entre les citoyens et les représentants du gouvernement et permet d'apporter une contribution plus significative à des décisions de politique publique précises de manière transparente et responsable (Phillips et Orsini, 2002; cités par le Conseil canadien de la santé, 2006).
Voici les critères que les décideurs ont établis pour que la participation du public soit éclairée, efficace et significative :
- une communication claire sur l'objet de la consultation et son rapport avec le processus décisionnel dans son ensemble,
- des liens identifiables entre la consultation et la décision prise en fin de compte,
- une information présentée clairement, avec honnêteté et intégrité,
- des règles de procédure qui favorisent un partage des pouvoirs et de l'information entre les participants et les décideurs,
- des processus que les citoyens et les décideurs considèrent légitimes.
La méthode se divise comme suit :
chapitre II : qu'est-ce que l'intervention des citoyens?
chapitre III : pourquoi une intervention des citoyens?
chapitre IV : institutionnaliser l'intervention des citoyens
chapitre V : faire intervenir des membres de populations précises
chapitre VI : faire intervenir les communautés autochtones
chapitre VII : démarrer
chapitre VIII : exemples de cas
chapitre IX : conseils pratiques
annexe A : aperçu des méthodes de participation du public
Étapes de l’utilisation de la méthode/de l’outil
La méthode comprend les sections qui suivent et d'autres parties à lire dans chacune d'elles.
Chapitre II : qu'est-ce que l'intervention des citoyens?
L'intervention des citoyens est axée sur un partage des pouvoirs et de l'information et sur le respect mutuel entre le gouvernement et les citoyens. Elle convient à toutes les étapes du processus d'élaboration des politiques, et permet d'insuffler les valeurs et les priorités des citoyens dans tout le processus d'élaboration des politiques de manière itérative. Les Canadian Policy Research Networks proposent un véritable dialogue et une délibération motivée comme moyen de générer des idées nouvelles et novatrices. Dans les processus d'intervention des citoyens, ces derniers se représentent eux-mêmes, au lieu de représenter des groupes d'intérêt.
Il existe trois genres de cadres d'intervention des citoyens :
- l'Association internationale pour la participation publique (AIP2) a mis au point l'IAP2 Public Participation Spectrum (pages 6 et 7 : www.iap2.org);
- le Community Engagement Framework de Vancouver Coastal Health (p. 8);
- le Continuum de participation du public de Santé Canada (p.8).
Chapitre III : pourquoi l'intervention des citoyens?
Récemment, la gouvernance est passée d'un modèle descendant à un modèle horizontal, qui consiste à gouverner par des réseaux de politique publique incluant des acteurs des secteurs public, privé et du bénévolat. Ce changement reposait sur la constatation que les décisions sont meilleures quand les parties concernées interviennent. Voici les avantages possibles de l'intervention des citoyens :
- prendre des décisions légitimes;
- établir de meilleures politiques;
- surmonter la polarisation, réduire les conflits et chercher un terrain d'entente;
- former des citoyens compétents et responsables;
- faire intervenir les citoyens dans la vie politique;
- inclure les minorités.
Chapitre IV : institutionnaliser l'intervention des citoyens
Au Canada, très peu de gouvernements ont institutionnalisé l'intervention des citoyens, qui englobe des éléments structurels et culturels. L'institutionnalisation exige que l'intervention des citoyens fasse normalement partie du processus d'élaboration des politiques et que le public et les responsables de l'élaboration des politiques la valorisent. Voici les quatre critères d'institutionnalisation :
- l'intervention du public est un élément encré dans le processus d'élaboration des politiques;
- l'avis du public pèse très lourd dans les processus d'élaboration des politiques; il ne peut être symbolique;
- l'engagement envers l'intervention institutionnalisée du public doit être respecté à l'échelle gouvernementale, et non concentré dans certains ministères;
- les efforts d'institutionnalisation de l'intervention du public sont déployés aussi par la fonction publique et le parlement.
Chapitre V : faire intervenir des membres de populations précises
Encore aujourd'hui, il est évident que certains groupes sont exclus de la participation en raison de barrières historiques. Plusieurs catégories d'exclusion se rapportent à des obstacles à la participation civile (reportez-vous au tableau 5 de la page 15). Par exemple :
- les barrières transsectorielles
- la pauvreté
- les Canadiens des communautés ethnoculturelles ou nouvellement arrivés
- l'âge
- l'aptitude
- le sexe
Chapitre VI : faire intervenir les communautés autochtones
Il y a de très solides motifs moraux, légaux, historiques et pratiques de faire intervenir les communautés autochtones lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant les politiques et les programmes qui touchent leur vie. Il faut s'attacher aux racines culturelles et structurelles de leur exclusion. L'intervention des citoyens peut faire progresser la réconciliation entre le gouvernement et les communautés autochtones. Le gouvernement de la Saskatchewan a établi une série de principes pour orienter la consultation des communautés autochtones. Voici certains d'entre eux :
- songer si l'action du gouvernement risque de nuire aux droits issus des traités ou à ceux des Autochtones quand de nouvelles initiatives sont créées ou des activités existantes sont modifiées;
- s'assurer que les consultations sont véritables et menées avec intégrité et de bonne foi afin qu'elles soient conformes à l'honneur de la Couronne;
- faire intervenir directement les peuples autochtones dans le processus de consultation;
- tenir compte de l'opinion des peuples autochtones dans le déroulement du processus de consultation;
- s'assurer que la consultationmène à l'établissement de relations respectueuses et durables.
Chapitre VII : démarrer
Le chapitre présente les étapes à suivre pour planifier et exécuter une initiative d'intervention des citoyens. Reportez-vous aux questions pour orienter le processus de planification qui sont posées aux pages 35 et 36.
A) Préparation
1. Déterminer les buts et la raison d'être, en plus d'évaluer le contexte : écouter, partager les pouvoirs et décider.
2. Évaluer les exigences de l'intervention des citoyens : moment, ressources, capacité, conditions de réussite.
Voici des questions à se poser :
- En quoi l'intervention des citoyens permettra-t-elle de respecter les orientations stratégiques et les buts de l'organisme ou du ministère?
- Quelle est la vision concernant le projet ou l'initiative et quel est le lien avec celle de l'organisme ou du ministère? En quoi cet aspect est-il transmis par le projet?
- Quelle est la décision à prendre ou la question à laquelle il faut répondre?
- Quel est le contexte fédéral, provincial ou régional?
B) Conception du processus
1. Créer une capacité interne : nouveaux rôles et nouvelles responsabilités : former le personnel à l'intervention des citoyens.
2. Présenter l'enjeu du point de vue du public.
3. Recrutement : aléatoire, calculé ou autosélectif
4. Logistique : heure, endroit et autres considérations
5. Choisir les méthodes pour atteindre les buts fixés : cadre de sélection des techniques d'intervention (p. 29)
6. Songer à l'intervention en ligne des citoyens.
7. Fournir des renseignements crédibles pour favoriser la participation des citoyens.
8. Facilitateurs ou animateurs du processus d'intervention des citoyens
9. Planifier l'évaluation et l'analyse.
10. Faire rapport aux décideurs et aux participants.
C) Mise en œuvre
1. Facteurs de réussite clés de la mise en œuvre
Chapitre VIII : exemples de cas
1. Comités consultatifs de santé communautaire de Vancouver Coastal Health
2. Commission Romanow sur l'avenir des soins de santé au Canada
3. Sous-comité sur la condition des personnes handicapées du Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées
4. Système de participation des locataires de la Toronto Community Housing Corporation
5. Ontario Citizen's Assembly on Electoral Reform
Chapitre IX : conseils pratiques
La Communauté canadienne pour le dialogue et la délibération (www.c2d2.ca/fr) offre aux professionnels des occasions de partager leurs expériences en matière d'intervention des citoyens.
Annexe A : aperçu des méthodes de participation du public
Sommaire des méthodes de participation du public suivantes :
- jurys de citoyens (p.49)
- panels de citoyens (p.50)
- conférences consensuelles (p.51)
- ateliers sur les scénarios (p.52)
- scrutins délibératifs (p.53)
- dialogues de citoyens (p.54)
Ces sommaires sont préparés par le CCNMO afin de condenser la matière et offrir un aperçu des ressources figurant dans le Registre des méthodes et outils, et pour fournir des suggestions quant à leur utilisation dans un contexte de santé publique. Pour plus d’information sur une méthode/un outil mentionné dans le sommaire, consultez les auteurs/développeurs de la ressource d’origine
Nous fournissons ces ressources et ces liens pour votre commodité et à des fins strictement informatives; ceux-ci ne signifient pas que l’Université McMaster cautionne ou approuve l’un ou l’autre des produits, des services ou des opinions des organisations externes, ni que les organisations externes ont cautionné la présentation de leurs ressources et de leurs liens par l’Université McMaster. L’Université McMaster n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’exactitude, de la légalité ou du contenu des sites externes.