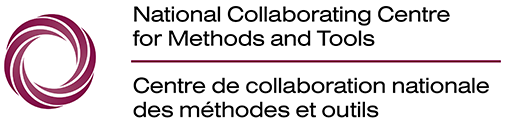Yuan, C.T., Nembhard, I.M., Stern, A.F., Brush, J.E., Krumholz, H.M. et Bradley, E.H. (2010). Blueprint for the Dissemination of Evidence-Based Practices in Health Care, Issue Brief: The Commonwealth Fund, à la page http://www.commonwealthfund.org/Content/Publications/Issue-Briefs/2010/May/Blueprint-for-the-Dissemination-of-Evidence-Based-Practices-in-Health-Care.aspx
Description
Le présent rapport expose dans leurs grandes lignes des stratégies clés pour disséminer des pratiques exemplaires au moyen de campagnes nationales d'amélioration de la qualité. Ces dernières ont pour objet de créer des communautés d'apprentissage qui se consacrent à changer les comportements à grande échelle, comme pour améliorer la qualité des soins de santé. Inspirée de quatre campagnes menées aux États-Unis, la méthode consiste à élaborer une stratégie en huit étapes de dissémination des innovations d'après les leçons apprises. Dans la littérature, deux termes connexes décrivent comment les idées, les innovations et les pratiques sont partagées entre les gens : diffusion et dissémination. La diffusion est le processus par lequel les renseignements sont transmis par certaines voies, sur une période donnée, parmi les membres d'un système social, de manière naturelle et passive. La dissémination se rapporte aux efforts conscients qui visent à propager de nouveaux renseignements parmi des publics précis, d'une manière planifiée et systématique (Green et coll., 2009). Le présent rapport est axé sur la dissémination active. Les développeurs ont créé, d'après la littérature, un cadre conceptuel de facteurs qui peut influencer la propagation de l'innovation. Ces facteurs s'inscrivent dans un continuum entre la diffusion pure (où la propagation se produit naturellement par des efforts décentralisés et informels) et la dissémination active (par des efforts centralisés et formels) où les groupes cibles se font convaincre d'adopter une innovation. Les voici : les caractéristiques de l'innovation les caractéristiques de l'organisme qui adopte l'innovation l'alignement de l'environnement externe la stratégie de dissémination La stratégie de dissémination est abordée à la partie sur le plan directeur des pratiques exemplaires en dissémination (reportez-vous aux étapes exposées ci-après). La présente ressource se compose des parties suivantes : Aperçu Campagnes nationales d'amélioration de la qualité et adoption de pratiques fondées sur des données probantes Méthodes d'étude Quatre campagnes nationales d'amélioration de la qualité Plan directeur des pratiques exemplaires en dissémination Caractéristiques de l'organisme qui adopte l'innovation Résumé et conclusions
Étapes de l’utilisation de la méthode/de l’outil
La méthode expose dans leurs grandes lignes huit stratégies pour disséminer des pratiques exemplaires. Les renseignements fournis pour chacune d'elles reposent sur les détails de quatre exemples de campagne d'amélioration de la qualité.
1re stratégie : Souligner la base de données probantes et la simplicité relative des pratiques recommandées. Les recommandations perçues comme étant fondées sur des données probantes et crédibles, mais aussi relativement simples, sont plus susceptibles d'être adoptées. Les campagnes réussies d'amélioration de la qualité sont avantagées comparativement à la pratique actuelle, sont faciles à adopter et peuvent être testées par tâtonnement.
2e stratégie : Aligner la campagne sur les objectifs stratégiques de l'organisme qui adopte l'innovation. Situer la campagne dans le contexte plus large des lignes directrices, des politiques et des mesures incitatives actuelles et des autres stratégies ayant pour but d'améliorer les soins.
3e stratégie : Intensifier le recrutement en incluant des leaders d'opinion dans le processus et en employant une structure organisationnelle nodale. L'un des aspects clés de la dissémination est la capacité de mobiliser une masse critique d'organismes pour qu'ils participent à la campagne. Dans une structure organisationnelle nodale,les bureaux extérieurs servent de nœuds pour ce qui est de faciliter, d'enseigner et de soutenir le travail à l'échelle locale.
4e stratégie : Former une coalition de commanditaires de campagne crédibles. Mobiliser des organismes professionnels et des dirigeants bien connus sur le terrain afin de donner de la crédibilité à la campagne.
5e stratégie : Créer un seuil d'organismes participants qui maximise les échanges de réseau. Si un nombre critique d'organismes semblables l'a fait ou envisage de le faire, cela peut influer grandement sur la décision d'un organisme d'adopter ou non les pratiques recommandées.
6e stratégie : Mettre au point des outils et des guides pratiques de mise en œuvre pour les principaux groupes d'étude. Les exemples de campagne ont permis de créer une série d'outils de mise en œuvre, comme des guides d'initiation, des trousses d'outils, des bulletins et des modèles à suivre. Des occasions structurées d'échanger des renseignements ont également été fournies et comprenaient des conférences téléphoniques, des webinaires, des ateliers et des communautés en ligne.
7e stratégie : Créer des réseaux afin d'offrir des occasions d'apprentissage. Les participants aux exemples de campagne se sont servis d'un réseau d'organismes inscrits pour apprendre ce qui a fonctionné dans d'autres organismes.
8e stratégie : Intégrer la surveillance et l'évaluation des repères et des buts. Il était impossible de mesurer des éléments précis des exemples de campagne; les seules données probantes sur l'impact qui pouvaient être générées concernaient les efforts globaux, comme pour mesurer l'amélioration totale des organismes participants. Il importe de définir et d'inclure les caractéristiques contextuelles clés de l'organisme qui adopte l'innovation, comme : le degré de besoin perçu de changer les pratiques; le degré d'ouverture à l'égard de sources externes de renseignements; le degré d'appui interne à l'égard des changements recommandés.
Ces sommaires sont préparés par le CCNMO afin de condenser la matière et offrir un aperçu des ressources figurant dans le Registre des méthodes et outils, et pour fournir des suggestions quant à leur utilisation dans un contexte de santé publique. Pour plus d’information sur une méthode/un outil mentionné dans le sommaire, consultez les auteurs/développeurs de la ressource d’origine
Nous fournissons ces ressources et ces liens pour votre commodité et à des fins strictement informatives; ceux-ci ne signifient pas que l’Université McMaster cautionne ou approuve l’un ou l’autre des produits, des services ou des opinions des organisations externes, ni que les organisations externes ont cautionné la présentation de leurs ressources et de leurs liens par l’Université McMaster. L’Université McMaster n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’exactitude, de la légalité ou du contenu des sites externes.